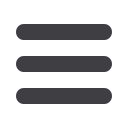
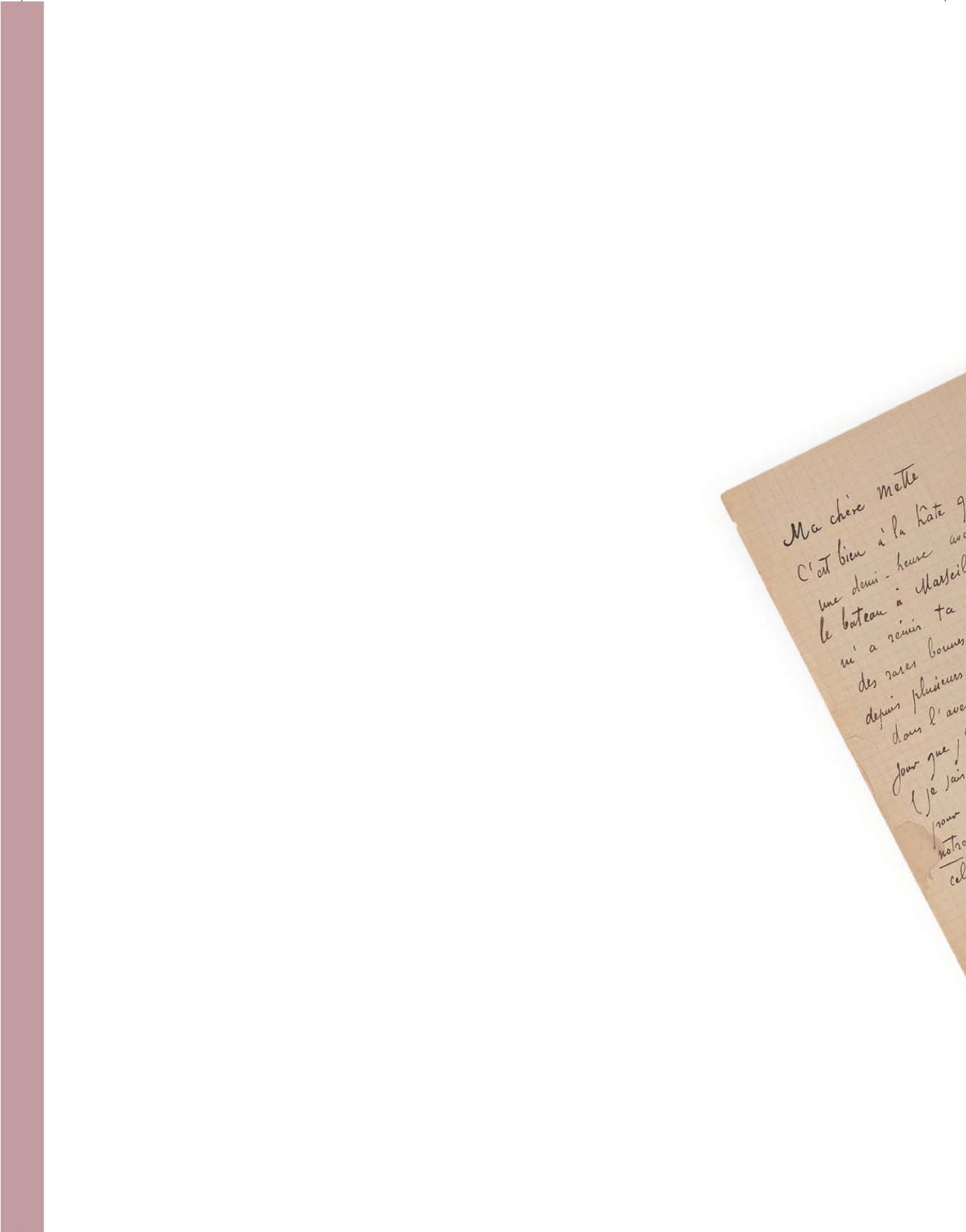
les collections aristophil
94
274
GAUGUIN PAUL (1848-1903)
Exceptionnel ensemble de 5 lettres
autographes signées adressées à son
épouse METTE
50 000 / 70 000 €
- [Paris, février 1891], 2 pages et demie in-8
à l’encre.
Gauguin prépare son voyage en
Océanie et compte pour cela sur la vente
publique de ses tableaux organisée le 22
février à Paris
. Il répond à une lettre de son
épouse qui a pensé à lui pour les fêtes de
Noël mais qui semble désireuse de ne plus
le revoir et condamne son projet de départ.
Qu’elle fasse ce qu’elle veut : « J’ai assez à
lutter pour mon art et sans encore me tuer à
petit feu dans des luttes de ménage […] D’ici
quelque temps tu recevras des journaux qui
t’indiqueront la place que j’ai prise en art et
doit me donner dans quelques années de la
sécurité. L’état m’achète deux tableaux ». Sa
femme lui reprochant son côté aventureux,
il réplique qu’il ne part pas pour coloniser
mais pour « vivre et travailler à des tableaux »
et quant à l’idée qu’il ne sera pas là-bas dans
le centre du mouvement, il affirme que « le
résultat dont j’ai à me féliciter aujourd’hui
est contraire au mouvement général. Je ne
suis pas les autres, on me suit ». Il termine
sa lettre en se plaignant de la sècheresse de
leurs rapports « […] J’espère que les enfants
comprendront un jour mieux que toi ce que
vaut leur père ».
- [Paris, 24 mars 1891], 4 pages in-8 à l’encre
sur papier ocre. (Petite tache d’encre violette).
Peu de temps avant son départ pour Tahiti,
au lendemain du banquet organisé en son
honneur et présidé par Mallarmé.
Gauguin
adopte un ton à la fois optimiste et doux-
amer, espérant revivre un jour avec sa
femme. Il imagine un avenir familial commun,
« ne pouvons nous avec des cheveux blancs
entrer dans une ère de paix et de bonheur
spirituel, entouré des enfants de notre chair
à tous deux », et regrette que sa belle-famille
entretienne leurs mauvaises relations. Il lui
fait part du succès du banquet de la veille :
« Nous avons bien dîné 45 personnes autour
de moi, peintres et littérateurs sous la
présidence de Mallarmé. Des vers des toasts
et des chaleureuses déclarations envers
moi ». Il lui répète qu’il a espoir un jour de
frapper un grand coup et de pouvoir subvenir
aux besoins de sa famille, « tu comprendras
peut-être un jour quel homme tu as donné
pour père à tes enfants ; j’ai l’orgueil de mon
nom que je veux faire grand et j’espère,
je suis sûr même que tu ne le saliras pas.
Même si tu rencontres un brillant capitaine »,
il demande à sa femme de veiller à ses
fréquentations quand elle viendra à Paris
et lui recommande de s’adresser à Charles
Morice dont il lui donne l’adresse. La mission
qui lui a été accordée par le gouvernement
et l’assurance que l’État lui achètera une toile
lui permettent de se montrer confiant pour
leur réinstallation commune : « à mon retour,
nous nous remarierons. C’est donc un baiser
de fiançailles que je t’envoie aujourd’hui […] ».
- [Marseille, 1
er
avril 1891], 4 pages in-8 à
l’encre sur papier quadrillé. (Petite mouillure
sur recto).
Très belle et émouvante lettre
d’adieux avant son premier départ pour
Tahiti, le 1
er
avril 1891
. Il écrit à son épouse
Mette une demi-heure avant d’embarquer à
Marseille (sur
L’Océanien
) en la remerciant de
sa bonne lettre remise par Charles Morice,
« une des rares bonnes que tu as écrites
depuis plusieurs années ». Il veut la persuader
d’avoir confiance en leur avenir commun, il
lui suggère notamment de venir à Paris et
de travailler comme traductrice pour les
éditions Hetzel avec l’aide de Morice, tout
en lui assurant que s’il pouvait subvenir seul
à leurs besoins, il le ferait : « tu n’aurais plus
rien à faire si toutefois tu m’aimes ». Il évoque
le Salon du Champ de Mars où l’on peut
voir une de ses sculptures : « Je n’y suis
pas entré par la porte ordinaire mais par
invitation expresse. Si j’en parle c’est que
plus tard c’est d’un bon augure. Que veux-tu.
Il faut beaucoup – beaucoup travailler dans
les arts pour arriver quand on est un artiste
original et révolutionnaire ». Il imagine qu’à
son retour, ils pourraient collaborer ensemble
à des traductions pour les éditions Hetzel. Il
l’embrasse « bien bien bien », lui demande de
l’aimer « plus qu’une Danoise », la conjure de
ne pas compter ses lettres et de ne pas peser
« la tendresse de mes expressions. Jamais
de calcul veux-tu ! ». En post-scriptum, il lui
demande de lui faire écrire par ses enfants
Aline et Émile, comme « devoirs français ».
- [Paris, novembre 1893], 5 pages in-8 à l’encre
sur double feuillet plié et un second feuillet à
part sur papier ocre.
Lettre écrite après son
retour de Tahiti, juste après l’exposition
chez Durand-Ruel en novembre 1893 où
Gauguin présenta son travail polynésien, ce
qui lui permit d’être considéré par certains
comme « le plus grand peintre moderne ».
Souffrant d’un rhumatisme important, il avoue
n’avoir pas eu grand courage à quoi que ce
soit. L’exposition n’a pas eu l’effet espéré
d’un point de vue financier parce que les prix
étaient très élevés, « Chez Durand-Ruel je
ne pouvais faire autrement eu égard aux prix
des Pissarro, Monet, etc… », mais il a recueilli
« un succès énorme d’artiste voir même
une fureur soulevée chez tous les jaloux. La
presse a été pour moi ce qu’elle n’a jamais
été pour personne c.a.d. excessivement
raisonnée et élogieuse. Je suis actuellement
pour beaucoup de personnes le plus grand
peintre moderne ». Il ne pourra pas se rendre
au Danemark, cloué à Paris par son travail, de
nombreux rendez-vous et par la préparation
d’un livre qui lui donne beaucoup de mal
[
Noa-Noa
, cet ensemble de notes sur la
culture tahitienne que Charles Morice devait
retravailler en 1895 et auxquelles Gauguin
ajouta des illustrations après être reparti pour
Tahiti. La première édition de ce manuscrit
sous forme de fac-similé date de 1954].
Il suggère à Mette la possibilité de louer
pour les vacances d’été une maison sur la
côte norvégienne avant de l’entretenir de
ses démarches auprès de Georges Brandès,
critique littéraire danois et beau-frère de
Mette, à qui le peintre veut racheter certaines
des toiles vendues par cette dernières. Il
lui laisserait facilement des Guillaumin et la
toile de Mary Cassatt, mais tient à avoir le
Manet, le Degas, les Pissarro, et les Cézanne…
















