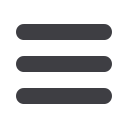
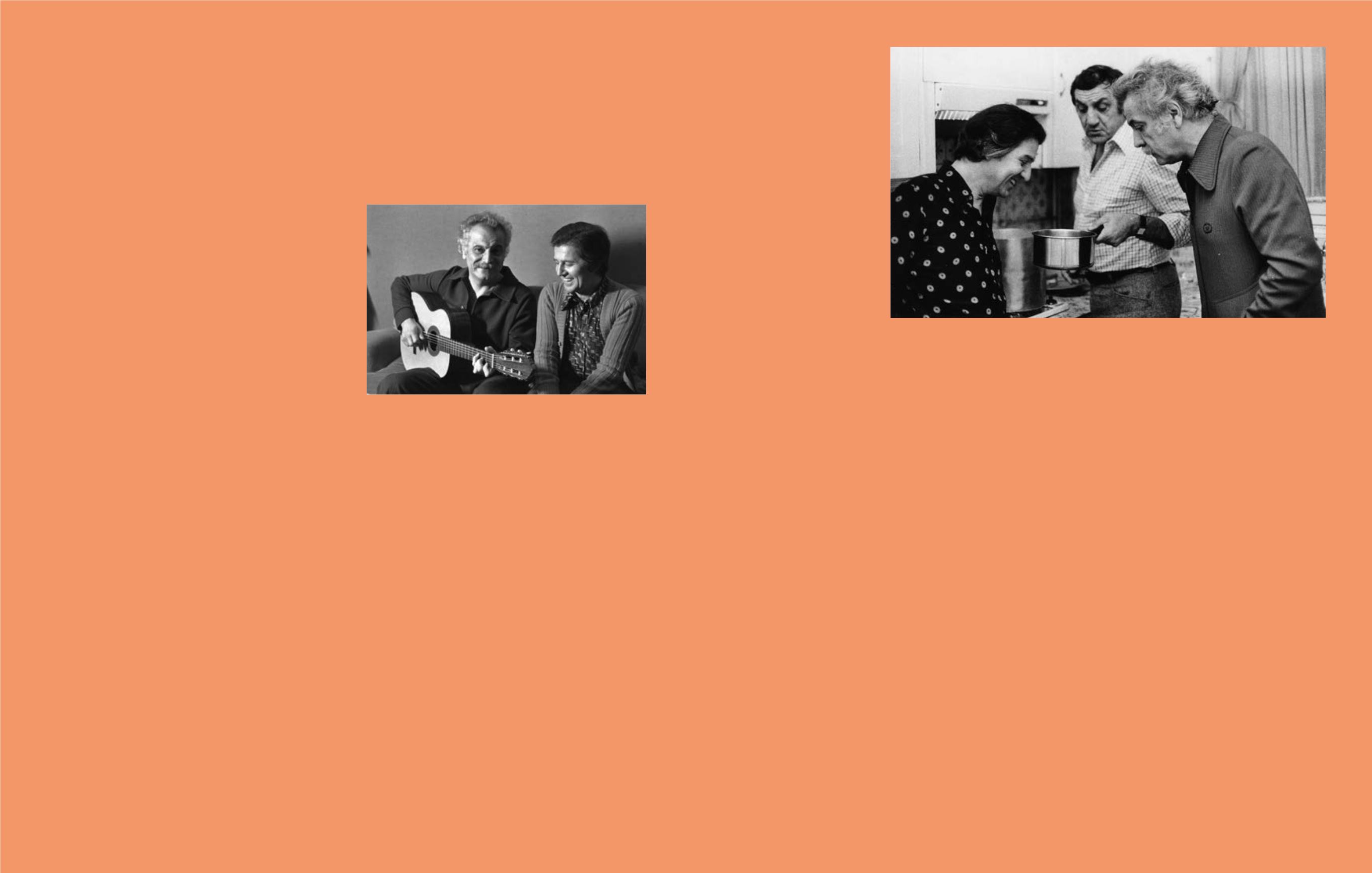
130
Livres & Manuscrits
RTCURIAL
22 septembre 2020 14h30. Paris
131
Livres & Manuscrits
RTCURIAL
22 septembre 2020 14h30. Paris
Georges Brassens à la guitare avec Fred Mella, 1973
Georges Brassens, en compagnie de Lino Ventura et Fred Mella, 1977
Les copains d’abord
GEORGES
BRASSENS
D.R.
D.R.
Le 6 Mars 1974, quelques
minutes avant le démarrage
du Grand Échiquier consacré
à Georges Brassens, un joyeux
aréopage est rassemblé en
coulisses. Parmi eux, celui que
j’appelle affectueusement « mon
père, ce crooner au sourire si
doux », que Georges avait affublé
du surnom de Galopin. Par
dérive affectueuse, j’en devins
un également. Georges était
dans sa loge, avec Gibraltar,
Pierre Nicolas, son bassiste, le
chanteur-guitariste Joël Favreau
et sa compagne, Püppchen.
Conversation animée de copains
ravis de se retrouver et liés par
leur amitié admirative pour
Georges. Papa, pas spécialiste
des bons mots ou aphorismes,
dit tout de même : « Quand on
me demande ce que je fais dans
la vie, je dis que je fais copain
de Brassens. » Preuve d’une
distanciation certaine, puisqu’il
était célèbre, non seulement
en France, mais dans le monde
entier. Rires, notamment de
Il faut dire qu’à l’époque de ses
débuts, en plus de Patachou et
quelques chanteurs, Brassens
a été vite interprété par les
Compagnons, tant dans
l’Auvergnat que la Prière. Mon
père, petit Rital ardéchois, monté
avec ses acolytes à Paris en 43, a
eu très vite des intuitions et des
fulgurances assez pointues pour
ce qui est des chansons. Pour
celles d’Aznavour, ce fut un vote
qui les introduisit au répertoire.
Les Compagnons de la Chanson
étant un groupe sans le moindre
contrat entre les membres,
les décisions se prenaient à la
majorité. Neuf, chiffre magique,
puisqu’impair. Quarante-trois
ans de carrière mondiale et pas le
moindre papier scellant le statut
du groupe, pas mal, non ? Rien
que pour ça, leur version des
Copains d’abord est pleinement
justifiée.
L’autre bande de copains, je les
ai vus attablés chez mes parents.
Lino aux fourneaux, concoctant
je mettais entre trois et quatre
jours, une semaine tout au plus.
« Ah », dit-il. Et dans ce « Ah »,
ma forfanterie m’apparut dans
toute sa gloire imbécile, sans qu’il
ait eu besoin d’en dire beaucoup
plus, car il avait une délicatesse et
une élégance de comportements
innées, ou dues à sa mère, cette
femme qui n’aimait pas les gros
mots de ses chansons lestes. Son
père, lui… (reportez-vous aux
Quatre Bacheliers). Même un
Galopin de mon acabit se voyait
considéré. C’est dire. L’effet du
« Ah » s’étant estompé, il me dit,
posément : « Moi, ça me prend
quatre ans » Oui, il étalait le
travail d’une rentrée parisienne
à l’autre, peaufinant, corrigeant,
effaçant, changeant d’angle, de
tournures, voire de mélodie. De
ce jour, j’ai revu mes batteries,
mes harmonies, mes strophes et
mes sujets.
Reconnaissons-lui quelques
exploits, peu communs et peu
connus : de la demeure de mes
parents, on pourrait presque
d’un bon dix centimètres. Et il
me regarde en coin. Je pleure !
Ajoutez à ça Félix Leclerc, son
accent trainant, son humour
celte, Marcel Amont et sa
virevoltance intellectuelle, alliée
à sa connaissance profonde
des arts plastiques, sans parler
de la plastique des femmes.
Ajoutez Fernand Raynaud, qui
se réconcilie avec Raymond
à propos d’un malentendu
artistique (voir le Grand
Echiquier, plus haut) et vous
comprendrez pourquoi « J’ai
passé des soirées à étonner les
princes » est une phrase qui me
colle aux basques.
Une bande de vieux gamins.
Mais dans le palmarès des
gamins, comme on dit de nos
jours, y a du lourd.
Côté littérature ou poésie,
Brassens pouvait être
intarissable, citant des pages
entières de Courteline, de
Maupassant, son littérateur
de chevet, des poèmes de
Lino Ventura et Raymond Devos,
comme des Compagnons,
dans les starting-blocks pour
l’émission.
Première minute, juste après le
générique et la présentation des
invités, Raymond s’engouffre
dans la conversation et cite le
mot de Papa, à la virgule près.
Bien évidemment, la saillie fait
mouche. Lino le regarde en coin,
mi-amusé, mi-interloqué. Papa,
quoique désarçonné, accuse
le coup. Mais, comme il nous
dit le lendemain à la maison,
Raymond donnait à tout une
telle aura. Et d’ajouter : « Si
Raymond l’a piqué, c’est que
c’était bien. » Mon père, comme
Georges, c’était un modeste. Cela
mis à part, la belle version des
Copains d’Abord par Georges
et les Compagnons, le bel envol
New Orleans du chorus et la
fierté du soliste de chanter aux
côtés de son ami, ça mettait du
baume au cœur et, avouons-le, ça
tapait une méchante gueule.
ses spaghettis légendaires, dans
les casseroles apportées de
chez lui. Raymond orientant
la conversation, de manière à
tester un nouveau sketch. On
s’étouffe dans la pasta, de rire,
bien sûr ; parce qu’elle est au
niveau de sa légende. Georges
et Lino, pour exorciser leur peur
de la mort, racontent tour à tour
des anecdotes d’enterrements,
en présence d’une amie à nous,
fraîchement veuve qui, elle aussi
rit de bon cœur, comme quoi…
Après le dîner, le piano passait
entre les doigts de Georges
Brassens, de Charles Aznavour
et de Georges Garvarentz, pour
un festival de Mireille et Nohain,
de Trenet, de Ray Ventura et
de Comedian Harmonists,
dont Georges s’était inspiré
pour imiter la trompette sur les
Copains d’abord. Lino, en forme,
dit à mon père qu’il le trouve
bien en jambes aussi et lui assène
une grande bourrasque dans
le dos, faisant avancer le cigare
que mon père venait d’allumer
avoir un descriptif fidèle puisque
les faux chandeliers et le
piano jouant des fausses notes
continuent de me tordre les
orteils de gêne. En revanche, le
chaume était sur le toit de chez
Maurice Biraud, près de l’église
de Goupillières à quelques
encablures de chez nous. Mais
le plus fort, c’est d’avoir fait venir
mon père pour chanter « Ils
ne savent pas ce qu’ils perdent,
tous ces fichus calotins, sans le
latin, sans le latin la messe nous
emmerde », pour Tempête
dans un Bénitier. Papa était
issu d’une famille catholique,
convertie tardivement peut-
être, mais assez rigoriste sur
les croyances et la verdeur du
langage. Assistant avec mes
enfants à un spectacle de mon
père en solo, dans les années
2000, je constatai qu’il rendait
un hommage vibrant à Georges,
en chantant un pot-pourri de
refrains connus, dont certains
qu’il avait chantés depuis les
années 50. Quand l’intro de «
Verlaine ou Hugo, Prévert et,
bien sûr, l’Apollinaire. Il avait
accepté de faire une apparition
cinématographique, pour faire
plaisir à l’auteur de Porte des
Lilas, l’extraordinaire René Fallet,
son ami profond, à qui il vouait
une admiration littéraire sans
borne ; plus réservé peut-être
quant aux délires amoureux
d’icelui. À force d’être accablé
par les amours à venir de
René, les amours présentes,
les ruptures cataclysmiques à
la suite desquelles le romancier
s’effondrait, il finira un jour par
écrire : « Parlez-moi d’amour
et j’vous fous mon poing sur la
gueule, sauf le respect que je
vous dois. »
À propos de temps, comme
il savait que je chatouillais la
guitare et versifiais des couplets,
plus ou moins bien ficelés, il me
demanda combien de temps
me prenait l’écriture d’une
chanson. Godelureau que j’étais,
je lui annonçai posément que
















