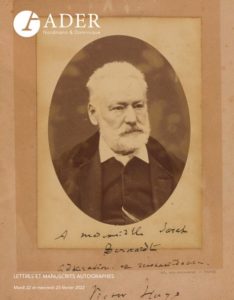Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, Comtesse de LAFAYETTE (1634-1693). Manuscrit, Caraccio. Histoire. Par Madame de La Fayette ; un volume in-8 (17,5 x 12 cm) de 87 ff. non chiffrés (y compris 1 f. de titre), reliure en veau brun de la fin du...
Description
Au XIXe s., un bibliophile provençal, Antoine de Saint-Ferriol, en eut la possession, comme en témoigne le cachet encre à ses armes figurant sur le titre.
Enfin, vers 1950, un autre bibliophile retrouva ce volume sur les rayons d’une librairie, et le communiqua à Bernard Pingaud, qui jugea l’œuvre « hélas ! d’une insigne médiocrité. Autant qu’on en peut juger, il s’agit d’une copie hâtive et maladroite faite à la fin du XVIIe siècle d’un brouillon de roman qui, comme l’Histoire espagnole, mais avec beaucoup moins d’élégance, s’apparente à Zaïde. Il est probable que nous sommes là en présence d’un des tout premiers essais de Mme de La Fayette ; il n’ajoute rien à sa gloire. » (Mme de La Fayette par elle-même, éd. du Seuil, 1959, p. 2 ; voir aussi son édition de romans de Mme de La Fayette chez Gallimard, Folio n° 778, p. 375-376).
Il s’agit en effet d’une copie, d’une écriture cursive mais lisible, à l’encre brune. Hormis un assez grand nombre de lettres, il n’existe pas de manuscrits autographes de Mme de La Fayette ; ils eussent permis de trancher définitivement les controverses touchant l’attribution des ouvrages publiés sous son nom après sa mort. On sait que Mme de La Fayette s’est toujours refusée à reconnaître les œuvres sorties de sa plume (sauf un Portrait de Mme la Marquise de Sévigné imprimé en 1659 dans un recueil de portraits à tirage restreint non destiné au commerce), sa position sociale lui faisant considérer comme inconvenant le métier de faire des livres. De là des problèmes d’attribution qui, avec diverses phases, n’ont pas cessé d’être soulevés du XVIIe s. à nos jours. S’agissant des trois romans (ou nouvelles) publiés de son vivant (la Princesse de Montpensier, Zaïde et la Princesse de Clèves), ces problèmes ne portent que sur le degré de collaboration de ses amis : Ménage, Segrais, Huet, La Rochefoucauld. Car des lettres de Mme de La Fayette et des témoignages de contemporains (notamment Segrais et Huet eux-mêmes) ne laissent aucun doute raisonnable sur la part prise par elle à l’élaboration de ces œuvres. Mais il n’en va pas de même des publications posthumes. Pour celles-ci (outre la critique interne des textes, toujours incertaine) l’attribution repose sur l’affirmation de l’éditeur, qui aura pu détenir des informations qui nous échappent aujourd’hui : ainsi de la Comtesse de Tende (publiée en 1718 et 1724), de l’Histoire d’Henriette d’Angleterre (1720) et des Mémoires de la cour de France (1731). Mais l’attribution repose aussi (et peut-être plus sûrement) sur les copies manuscrites anciennes, de la fin du XVIIe s. ou du début du XVIIIe (donc antérieures aux publications) qui donnent explicitement les deux premiers ouvrages cités ci-dessus à Mme de La Fayette. L’un de ces manuscrits (conservé à Munich) contient, à la suite de ces deux textes, l’unique copie de l’Histoire espagnole (publiée seulement en 1909). La page de titre donne comme auteur de ce récit Mme de La Fayette, et ce fait constitue la base (certes fragile) de l’attribution ; c’est sur une semblable base que repose l’attribution de Caraccio au même auteur.
Les négligences du manuscrit de Caraccio (nombreux mots répétés, quelques-uns peut-être sautés) justifient les termes de « copie hâtive et maladroite » employés par B. Pingaud. La ponctuation en est presque entièrement absente, et l’orthographe des plus fantaisiste ; mais les lettres autographes de Mme de La Fayette présentent les mêmes défauts. Quant aux nombreuses phrases bancales, elles témoignent sans doute, plus que de la négligence du copiste, qu’il s’agirait de la copie d’un brouillon, du premier jet d’un roman que l’auteur n’aura pas jugé digne d’être retravaillé et poli comme le furent Zaïde ou la Princesse de Clèves, laquelle n’est pourtant pas exempte de maladresses syntaxiques, comme on l’a remarqué depuis Valincour. Pour revenir sur l’orthographe, notons ce détail : à la fin du roman figurent ces deux vers : « Ainsy se vit enfin, par le noeud d’himenée. De ces quatres amans la flame couronnée ». Une main attentive a biffé le mot quatres et (d’une autre écriture) l’a remplacé par le mot heureux. Or ce mot quatres se retrouve, écrit avec une s, dans une lettre à Ménage d’août 1662 (lettre 62-9 des Œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade), ainsi qu’on peut le voir par la reproduction qu’en donne, dans l’orthographe d’origine, H. Ashton dans son étude sur Madame de La Fayette, sa vie et ses œuvres (Cambridge, 1922, p. 82).
C’est à Zaïde que s’apparente le plus Caraccio, et cela par plusieurs aspects. Sa structure d’ensemble tout d’abord, qui est à vrai dire inspirée des romans de Mlle de Scudéry et de La Calprenède. Le récit principal commence au milieu de l’action : Caraccio vient au secours de deux inconnus dans un combat inégal (ce sont en réalité un homme, et sa sœur habillée en homme ; cette même situation se retrouve dans l’Histoire espagnole). Leurs ennemis une fois mis en fuite, les trois compagnons prennent du repos, et Caraccio fait aux deux autres le récit de ses aventures, occasionnées par la poursuite de son amante Almeria enlevée par un rival. Ce récit rétrospectif (ff. 4 à 73), est interrompu par trois récits incidents : l’histoire d’Henares et Valeria, deux amants eux aussi séparés (ff. 17 à 22), l’histoire du philosophe retiré dans une solitude en Egypte (ff. 33 à 50), enfin l’histoire d’Almeria depuis son enlèvement (ff. 66 à 71). Le récit de Caraccio est suivi du récit des aventures du frère et de la sœur qu’il a secourus (ff. 74 à 81). Puis le récit principal reprend : les trois compagnons arrivent dans une auberge où Caraccio retrouve son ami Henares (accompagné de Valeria), et finalement son amante Almeria. Tout ce monde prend le chemin de Valence, leur ville natale, où se célébrera le mariage des deux couples.
Ce n’est pas seulement par ces trois éléments (commencement du roman au milieu de l’action et récit rétrospectif, emboîtement des récits, et fin heureuse) que Caraccio rappelle Zaïde, c’est aussi par la multiplicité des aventures. Les personnages ne cessent de voyager ; Caraccio, parti de Valence, et pris par des corsaires barbaresques, arrive esclave à Ceuta, puis, racheté, se rend à Alep, Tunis, Alexandrie, traverse l’Arabie, revient à Tripoli (de Libye) avant de regagner l’Espagne. Les tempêtes, naufrages, attaques de corsaires ne se comptent pas. L’état d’esclave en pays musulman est le lot, outre Caraccio, d’Almeria, de Valeria, et du philosophe retiré en Égypte, dont la fuite de prison par un sépulcre souterrain est longuement contée. Les combats ne manquent pas (y compris contre un ours). D’autres détails rappellent, davantage que les romans de Mlle de Scudéry, les Histoires tragiques que Mme de La Fayette, grande lectrice de romans, connaissait sûrement : empoisonnements, tentative de viol, meurtre d’un fils par son père à l’instigation de sa nouvelle épouse, et meurtre de cette marâtre par un autre fils, la femme d’un Mouphti de Tripoli ayant accouché d’un enfant noir, le Mouphti étrangle tous ses esclaves noirs, tue l’enfant et veut le faire manger à sa mère, qu’il tue sur son refus.
Si les tribulations des différents personnages ont pour principale cause la passion amoureuse, l’effet des passions sociales et politiques (l’envie, l’ambition) n’est pas tout-à-fait oublié. Le père de Caraccio, à qui la jalousie de courtisans a fait perdre la place éminente qu’il occupait auprès du vice-roi de Valence (on notera le parallèle avec le père de Consalve dans Zaïde), fait à son fils un sombre tableau du monde, dénonce « »les apparences trompeuses d’une cour séduisante », le pouvoir de l’or, ce « vil métal », la fausseté de toutes les relations sociales, et prononce que « les hommes qui le [le monde] composent n’ont point conservé la candeur de leurs ancêtres ». Plus loin Caraccio dira au philosophe retiré dans une solitude en Égypte : « vous êtes, je crois, le seul dans l’univers qui avez conservé dans vos mœurs la candeur de nos ancêtres ». Ce philosophe enseigne à Caraccio une vertu appuyée sur la raison. Il parle aussi d’un étrange élixir qu’il a composé pour guérir les blessures de l’âme en en ôtant les passions (vaine présomption, luxure, envie, etc.). Car si Caraccio et les autres personnages du roman sont victimes du destin, de la fortune, de l’inconstance du sort (tous ces termes reviennent sans cesse), et si d’autre part la continuation de la passion amoureuse est nécessaire au roman et à son aboutissement à une fin heureuse (le mariage), la recherche de la tranquillité, la tentative d’échapper au trouble des passions n’est pas absente. Les bois, les déserts, les solitudes peuvent être les lieux où les amants vont se livrer aux « rêveries que cause ordinairement le venin de l’amour », exhaler leur « mélancolie profonde » ; mais il arrive aussi qu’ils proposent ce « repos » tant désiré par la princesse de Clèves, comme cette grotte « en laquelle la nature avait épuisé tout son art », que Caraccio aménage commodément et où il passe quatre mois. « Là, tranquille, j’osois comparer mon bonheur à celui des plus heureux mortels. La solitude, depuis mes disgrâces, me plaisoit infiniment. J’oubliai tous mes chagrins. Je fis même la résolution d’y finir mes jours, j’éloignai de moi toutes les pensées auxquelles j’avois été livré après tous mes maux.[…] Mais, hélas ! comme il n’est point de plaisirs qui n’aient leurs traverses, et comme l’homme ne peut porter son bonheur avec tranquillité, il ne dura que quatre mois. Mon ancienne passion qui n’étoit point absolument éteinte en troubla le cours, les reproches qu’elle me faisoit en moi-même d’avoir oublié Almeria, celle qui m’avoit causé tant de maux par la tendre affection que j’avais pour elle, la ralluma entièrement ». Comment ne pas penser à cette « passion endormie » qui « se ralluma » dans le cœur de la princesse de Clèves à la vue de M. de Nemours « enseveli dans une rêverie profonde » sur le banc d’un jardin ?
Certes Caraccio ne saurait se comparer en aucune façon à la Princesse de Clèves. En particulier, l’analyse psychologique y est tout-à-fait rudimentaire, et surtout n’y joue pas le rôle moteur (de même dans Zaïde). Ce n’est tout au plus qu’une ébauche, et probablement, comme l’a vu B. Pingaud, un essai dû à la plume d’une jeune débutante, imbue des romans qu’elle a aimés. En témoignerait aussi la naïveté de certaines maximes qui parsèment le roman : « l’on n’arrive pas toujours au but que l’on se propose », « cette mort nous causa bien du chagrin, mais comme on se console aisément des choses indifférentes, nous ne songeâmes qu’à nous rétablir nous-mêmes »… Ces maximes (on sait d’ailleurs que la maxime est un trait du style de Mme de La Fayette) pourraient trahir dans leur naïveté une sagesse trop précoce de jeune personne, comme aussi le sombre tableau de la société, des intrigues politiques et de la violence des passions que l’on trouve dans Caraccio. Ce roman n’aurait-il pas été écrit dans l’exil de Champiré, où celle qui était encore Mlle de La Vergne, âgée de 19 ans, dut suivre son beau-père compromis avec les Frondeurs ?